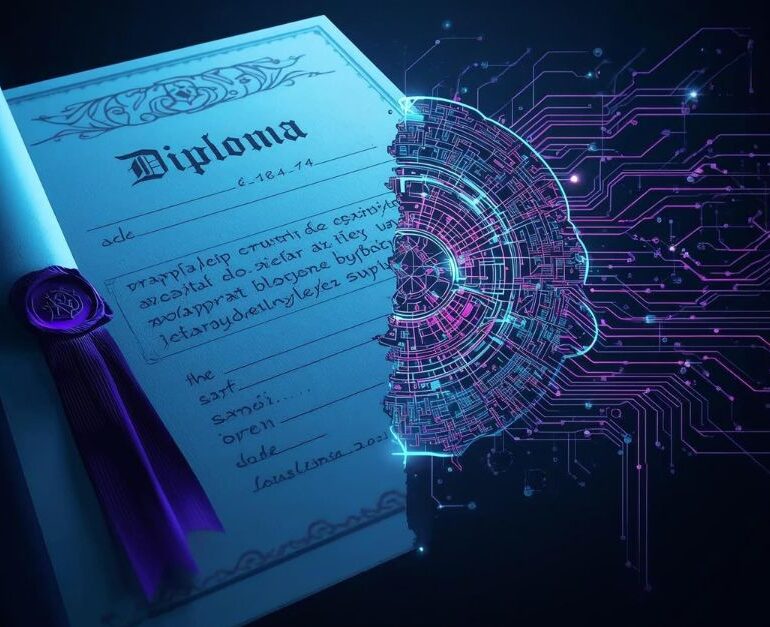La cybersécurité n’a jamais été aussi stratégique qu’aujourd’hui. Entre ransomwares sophistiqués, campagnes de phishing dopées à l’intelligence artificielle et failles dans les infrastructures cloud, les organisations font face à un paysage de menaces en perpétuelle mutation. Pour y voir plus clair, nous avons eu le privilège d’échanger avec Anas Chanaa, expert reconnu en cybersécurité, dont l’expérience couvre l’audit, le pilotage de centres opérationnels de sécurité (SOC) et le conseil stratégique auprès d’entreprises de toutes tailles.
Dans cet entretien, Anas livre une analyse sans détour des enjeux actuels, décortique les erreurs les plus courantes qui minent la posture de défense des entreprises, et propose des leviers concrets pour bâtir une résilience numérique durable. Au-delà des outils et des technologies, il met l’accent sur l’importance d’une gouvernance claire, d’une culture de la sécurité partagée, et d’une approche pragmatique qui aligne protection technique et objectifs métier.
Ce dialogue offre un panorama complet et accessible, aussi bien aux responsables IT qu’aux dirigeants soucieux de protéger leur organisation dans un monde hyperconnecté 🔐.
Parcours et mission
Anas Chanaa a construit son expertise au fil d’expériences variées qui lui ont permis d’appréhender la cybersécurité sous tous ses angles. Après avoir débuté dans l’audit de sécurité, où il évaluait la robustesse des systèmes d’information et identifiait les vulnérabilités avant que les attaquants ne les exploitent, il a ensuite piloté des équipes au sein de centres opérationnels de sécurité. Cette immersion dans le quotidien de la détection et de la réponse aux incidents lui a appris l’importance de la réactivité, de la coordination et de la clarté des processus en situation de crise.
Aujourd’hui consultant, Anas accompagne des organisations de toutes tailles dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie de cybersécurité. Son rôle consiste à évaluer les risques en fonction du contexte métier de chaque client, à prioriser les mesures de protection en tenant compte des contraintes budgétaires et opérationnelles, et à orchestrer la réponse aux incidents pour minimiser l’impact sur l’activité. Ce qui distingue son approche, c’est sa volonté constante d’aligner sécurité et métiers. Trop souvent, la cybersécurité est perçue comme une contrainte technique isolée, une « sécurité en silo » déconnectée des réalités du terrain.
Anas insiste sur la nécessité de faire dialoguer les équipes IT, les responsables métier et la direction générale pour construire une posture de défense cohérente et partagée, où chacun comprend son rôle et ses responsabilités face aux cyber-risques.
Les menaces clés en 2025
Lorsqu’on interroge Anas sur les menaces les plus préoccupantes en cette année 2025, il dresse un tableau à la fois précis et inquiétant. Le ransomware reste le fléau numéro un, mais il a considérablement évolué. Les attaquants ne se contentent plus de chiffrer les données pour réclamer une rançon : ils pratiquent désormais la « double extorsion », exfiltrant les informations sensibles avant de les chiffrer, puis menaçant de les publier si la victime refuse de payer. Cette tactique met une pression énorme sur les organisations, notamment celles soumises à des obligations de confidentialité strictes. Parallèlement, le phishing a franchi un nouveau cap grâce à l’intelligence artificielle générative.
Les campagnes d’hameçonnage sont désormais personnalisées, rédigées dans un langage impeccable et reproduisant à la perfection le style des communications internes d’une entreprise. Les collaborateurs, même formés, peuvent se laisser piéger par des messages d’une crédibilité bluffante. Anas souligne également la montée en puissance des attaques visant la chaîne d’approvisionnement numérique 🔗. Les cybercriminels exploitent les maillons faibles des écosystèmes connectés : prestataires tiers, solutions SaaS mal sécurisées, dépendances logicielles non auditées. Une brèche chez un fournisseur peut ainsi compromettre des dizaines, voire des centaines d’organisations clientes.
L’exposition accidentelle de secrets et de données sensibles via des erreurs de configuration cloud constitue une autre source de préoccupation majeure. Des buckets S3 laissés ouverts, des clés d’API publiées par inadvertance sur GitHub, des bases de données mal protégées : autant de portes d’entrée pour les attaquants. Enfin, l’ingénierie sociale reste redoutablement efficace, avec des scénarios de détournement d’authentification qui exploitent la confiance et les faiblesses humaines bien plus que les vulnérabilités techniques.
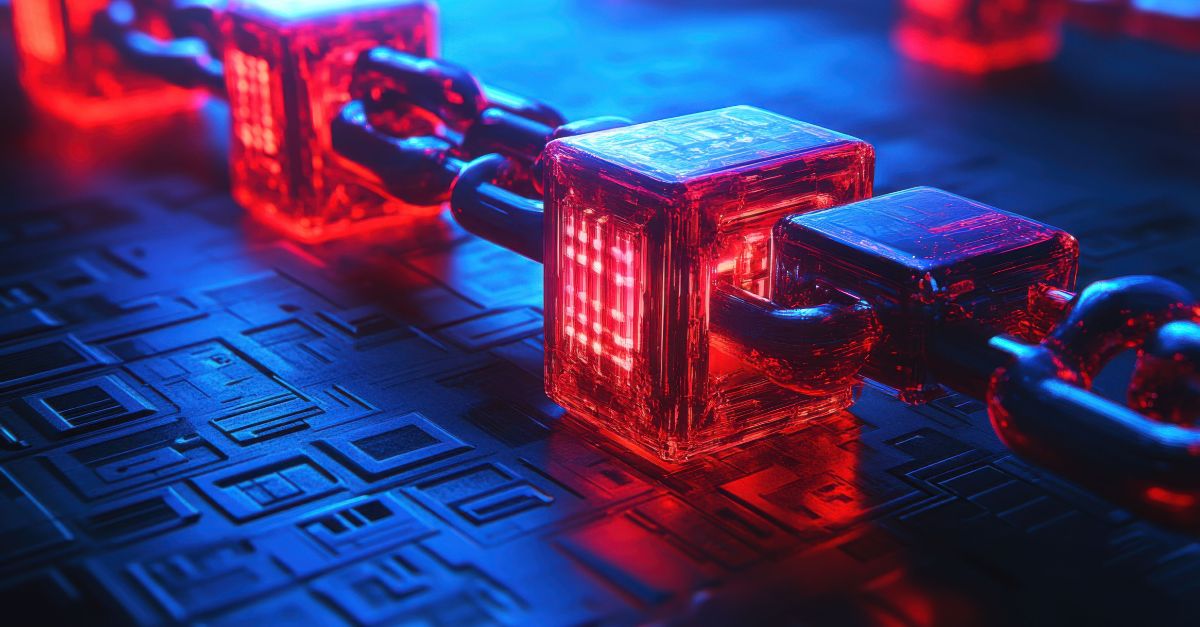
Erreurs fréquentes
Au fil de ses missions, Anas a identifié une série d’erreurs récurrentes qui fragilisent inutilement la posture de sécurité des organisations. La première, et sans doute la plus répandue, consiste à confondre conformité et sécurité réelle. Cocher les cases d’un référentiel réglementaire ne garantit pas une protection efficace face aux menaces concrètes. Certaines entreprises se contentent de satisfaire les exigences minimales d’un audit pour obtenir une certification, sans pour autant mettre en place les processus et les contrôles qui feront vraiment la différence en cas d’attaque.
Une autre erreur courante est de déployer des outils technologiques sophistiqués sans avoir défini au préalable les processus d’utilisation ni désigné les responsables. Un SIEM (Security Information and Event Management) qui génère des milliers d’alertes non traitées, un pare-feu applicatif web mal configuré, un logiciel EDR (Endpoint Detection and Response) laissé en mode passif : tous ces investissements coûteux deviennent inutiles, voire contre-productifs, faute de gouvernance. Anas pointe également du doigt la négligence chronique en matière de gestion des identités.
L’absence de multi-facteur d’authentification (MFA) sur les comptes à privilèges, des droits d’accès accordés de manière trop large et jamais revus, des mots de passe faibles ou réutilisés : autant de failles béantes que les attaquants exploitent en priorité. Le manque de sauvegardes testées et l’absence de plan de reprise d’activité opérationnel constituent une autre lacune critique. Trop d’organisations découvrent, au moment d’un ransomware, que leurs sauvegardes sont corrompues, incomplètes ou inaccessibles.
Enfin, la sous-estimation de la formation continue des équipes reste un problème majeur : la cybersécurité évolue vite, et des collaborateurs non sensibilisés ou mal informés représentent le maillon faible de toute stratégie de défense 🛡️.
Bonnes pratiques
Face à ces défis, Anas Chanaa propose une feuille de route claire, fondée sur des principes éprouvés et des actions concrètes. Tout commence par l’hygiène de base, un terme qui peut sembler modeste mais qui recouvre des mesures essentielles : maintenir un inventaire à jour des actifs numériques, appliquer les correctifs de sécurité rapidement, durcir les configurations des systèmes et des applications, et activer une journalisation systématique des événements de sécurité. Ces fondamentaux, souvent négligés au profit de solutions plus spectaculaires, forment le socle d’une défense efficace.
La gestion des identités et des accès mérite une attention particulière. Le déploiement du MFA sur tous les comptes, et particulièrement sur ceux disposant de privilèges élevés, doit devenir une priorité absolue. Le principe du moindre privilège impose de n’accorder à chaque utilisateur que les droits strictement nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, et de réviser régulièrement ces permissions pour éviter l’accumulation d’accès obsolètes. Les sauvegardes doivent être chiffrées, stockées hors ligne (ou sur des supports déconnectés) et testées régulièrement pour vérifier leur intégrité et leur capacité à restaurer les données en cas de besoin. Un plan de reprise d’activité doit être documenté, connu de tous les acteurs concernés, et exercé au moins une fois par an.
La détection et la réponse aux incidents reposent sur une combinaison d’outils et de processus : un SIEM correctement configuré, un SOC capable de trier et d’analyser les alertes, des playbooks d’incident clairs qui définissent qui fait quoi en cas de compromission, et des exercices de simulation (red team, blue team, purple team) qui permettent de tester la réactivité des équipes. Dans le contexte cloud, Anas recommande une vigilance accrue sur les configurations, une gestion rigoureuse des clés d’API et des secrets, et la mise en place d’alertes automatiques en cas de modification suspecte ou de tentative d’accès non autorisé.
Enfin, la sensibilisation des collaborateurs ne doit jamais être négligée : campagnes de phishing simulé, formations interactives, communication régulière sur les menaces du moment et les bonnes pratiques à adopter au quotidien. L’objectif est de créer une véritable culture de la sécurité, où chaque employé se sent acteur de la protection de l’organisation.
Conformité et gouvernance
Anas Chanaa insiste sur le lien étroit entre sécurité opérationnelle et conformité réglementaire. Des textes comme la directive NIS2, le RGPD ou encore la norme ISO/IEC 27001 ne sont pas de simples contraintes administratives : ils offrent un cadre structurant qui aide les organisations à définir et à formaliser leur posture de sécurité. La conformité impose de cartographier les actifs, d’identifier les données sensibles, d’évaluer les risques de manière méthodique et de documenter les mesures de protection mises en place. Elle oblige également à nommer des responsables clairement identifiés, à définir des politiques de sécurité cohérentes, et à réaliser des audits réguliers pour vérifier l’application effective des règles.
Cette gouvernance, souvent perçue comme pesante, apporte en réalité une discipline précieuse : elle force les organisations à se poser les bonnes questions, à prioriser les investissements en fonction des risques réels, et à assurer une traçabilité des décisions et des actions. Anas rappelle toutefois qu’il ne faut pas confondre le respect formel des exigences réglementaires avec une sécurité réelle et efficace.
La conformité est un point de départ, un socle minimum, mais elle doit être complétée par une approche proactive, adaptée aux menaces spécifiques auxquelles chaque organisation est exposée. Les audits externes, les tests d’intrusion et les exercices de crise permettent de valider que les contrôles décrits dans les documents fonctionnent réellement sur le terrain.
Intelligence artificielle
L’intelligence artificielle bouleverse le champ de la cybersécurité, et Anas Chanaa adopte à son égard une posture nuancée. D’un côté, l’IA offre aux attaquants de nouveaux moyens d’automatiser et d’accélérer leurs campagnes : génération de messages de phishing ultra-personnalisés, reconnaissance automatique des infrastructures cibles, création de logiciels malveillants polymorphes capables d’échapper aux antivirus classiques. Ces capacités abaissent la barrière à l’entrée pour les cybercriminels moins expérimentés et augmentent la vitesse de propagation des menaces.

Mais de l’autre côté, l’IA constitue également un levier puissant pour la défense 🤖. Les solutions basées sur l’apprentissage automatique permettent de détecter des anomalies subtiles dans les comportements des utilisateurs ou des systèmes, de trier et de prioriser les alertes pour soulager les analystes SOC submergés, et d’identifier des corrélations entre événements que l’œil humain aurait du mal à percevoir. Anas met néanmoins en garde contre une adoption aveugle de ces technologies. La qualité des modèles d’IA dépend directement de la qualité des données d’entraînement : des données biaisées ou incomplètes produiront des résultats peu fiables.
L’explicabilité des décisions prises par les algorithmes est un autre enjeu crucial : en matière de sécurité, il est essentiel de comprendre pourquoi une alerte a été levée, et de pouvoir justifier les actions entreprises. Enfin, le contrôle humain reste indispensable : l’IA doit assister, accélérer et enrichir le travail des équipes de sécurité, mais jamais se substituer totalement au jugement et à l’expertise des professionnels.
Conseils aux PME et collectivités
Les petites et moyennes entreprises, ainsi que les collectivités territoriales, disposent rarement des budgets et des ressources humaines des grandes organisations. Pourtant, elles ne sont pas épargnées par les cyberattaques, bien au contraire : elles constituent souvent des cibles privilégiées, car elles sont perçues comme moins bien protégées. Anas Chanaa leur adresse des recommandations pragmatiques, adaptées à leurs contraintes.
La première consiste à commencer par les risques critiques métier : identifier les processus, les systèmes et les données dont la compromission aurait l’impact le plus grave sur l’activité, et concentrer les efforts de protection sur ces éléments. Il ne s’agit pas de tout sécuriser du jour au lendemain, mais de prioriser intelligemment. L’externalisation auprès de prestataires spécialisés (MSSP, Managed Security Service Providers) peut être une solution pertinente pour bénéficier de compétences pointues sans recruter une équipe complète en interne.

Anas insiste néanmoins sur la nécessité de garder la gouvernance : même externalisée, la responsabilité de la sécurité reste celle de l’organisation, qui doit définir les objectifs, valider les choix et contrôler la qualité des services rendus. En matière d’outils, mieux vaut choisir quelques solutions bien intégrées, faciles à piloter et dont l’efficacité est mesurable, plutôt que d’accumuler des produits redondants qui génèrent plus de complexité que de valeur ajoutée. Enfin, mettre en place un plan de réponse aux incidents simple et testé est indispensable : savoir qui contacter en cas de problème, comment isoler un système compromis, comment communiquer en interne et en externe, et comment restaurer l’activité rapidement.
Ces quelques mesures, accessibles et pragmatiques, permettent déjà de réduire considérablement la surface d’attaque et d’améliorer la résilience.
Parcours professionnel et compétences
Pour celles et ceux qui aspirent à rejoindre le domaine de la cybersécurité, Anas Chanaa trace un chemin fait de curiosité, d’apprentissage continu et de pratique concrète. Les fondamentaux techniques restent indispensables : une solide compréhension des réseaux (protocoles, architecture, segmentation), des systèmes d’exploitation (Linux, Windows, Unix), et des mécanismes de sécurité applicative (OWASP, développement sécurisé).
La maîtrise de la gestion des identités et des accès (IAM), ainsi que des enjeux spécifiques au cloud (AWS, Azure, GCP), est devenue incontournable dans un monde où les infrastructures sont de plus en plus hybrides et distribuées. Les compétences en audit et en gestion des risques permettent de structurer la démarche et de dialoguer avec les directions. Mais au-delà de la technique, Anas souligne l’importance des soft skills : la capacité à communiquer clairement avec des interlocuteurs non techniques, à expliquer les enjeux de sécurité en termes business, à gérer une crise avec sang-froid et à coordonner des équipes pluridisciplinaires.
Les certifications reconnues, telles que ISO 27001 Lead Implementer, SOC Analyst, Cloud Security Specialist ou encore les certifications SANS/GIAC, constituent des atouts précieux pour structurer ses connaissances et valoriser son expertise sur le marché. Mais Anas rappelle que la cybersécurité est un domaine en perpétuelle évolution : la veille, la participation à des conférences, les échanges au sein de communautés et la pratique régulière (CTF, labs, bug bounty) sont tout aussi essentiels que les diplômes pour rester à jour et pertinent.
Pour finir…
Le message qu’Anas Chanaa souhaite avant tout transmettre est simple, mais fondamental : la cybersécurité est un processus continu, pas un produit qu’on achète une fois pour toutes. Aucun outil miracle, aussi sophistiqué soit-il, ne garantira une protection absolue. Ce qui fait la différence, c’est la combinaison d’une hygiène rigoureuse, d’une gouvernance claire, d’une préparation aux incidents et d’une culture de la sécurité partagée par tous les collaborateurs.
Investir dans ces dimensions, souvent moins spectaculaires que l’achat de solutions techniques tape-à-l’œil, apporte le meilleur retour sur investissement et permet de construire une résilience durable. La collaboration entre équipes IT, responsables métier et direction est le ciment de cette démarche : elle assure que les décisions de sécurité sont alignées sur les objectifs stratégiques de l’organisation, que les risques sont compris et assumés en connaissance de cause, et que chacun se sent responsable de la protection du patrimoine numérique commun.
Dans un monde où les menaces se sophistiquent chaque jour, cette approche globale, pragmatique et humaine reste la meilleure voie pour naviguer en sécurité 🚀.